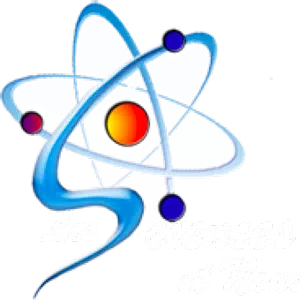Auteurs Véronique Agin – Professeur en neurosciences, Université de Caen Normandie
Denis Vivien Professeur en biologie cellulaire et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire Caen Normandie, Université de Caen Normandie
Le rôle de l’art dans la prévention en santé, mais aussi dans l’aide à la prise en charge des malades dans différentes pathologies, est de plus en plus accepté. Mais ses bénéfices doivent encore être validés en respectant les normes des essais cliniques. C’est l’objectif d’un projet de recherche mené au musée des Beaux-Arts de Caen, en Normandie, qui allie neurosciences, psychologie et sciences numériques.
Définir l’art et la santé est une question difficile mais fondamentale avant d’initier une recherche sur les liens entre les arts et la santé.
L’œuvre d’art est valorisée en soi, sa finalité n’est pas d’être utile. Elle incarne la nouveauté, la créativité, l’originalité, le travail de recherche et le savoir-faire de l’artiste. Elle suscite en outre l’imagination et l’expression émotionnelle aussi bien chez l’artiste que chez le spectateur.
La santé, quant à elle, peut être définie comme un état de bien-être mental, physique et social, et non pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité, ce qui ancre ainsi fermement la santé dans la société et la culture.
De nombreux articles scientifiques affirment que les arts pourraient améliorer la santé, et donc le bien-être des individus. En 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a répertorié deux grandes catégories d’effets possiblement bénéfiques des arts sur la santé : prévention et promotion de la santé, prise en charge et traitement.
Un projet qui rassemble neurosciences, psychologie et sciences numériques
L’art peut-il améliorer la santé et donc le bien-être ?
Pour contribuer à lever les incertitudes, nous menons un projet pluridisciplinaire « Art, bien-être et cerveau » qui rassemble les neurosciences (laboratoire PhIND : UMR-S Inserm 1237), la psychologie (laboratoire NIHM : UMR-S 1077 ; laboratoire LaPsyDÉ : UMR CNRS 8240) et les sciences numériques (laboratoire GREYC : UMR CNRS 6072).
Cette recherche innovante, menée au musée des Beaux-Arts de Caen, a pour objectif de mesurer, in situ, les effets procurés par la visite d’un musée dédié à la peinture sur le bien-être, chez des adultes en bonne santé âgés de 18 à 65 ans.
Il s’agit également d’identifier les mécanismes cérébraux, cognitifs et socioémotionnelsassociés à ces effets, grâce à des mesures exhaustives et écologiquement adaptées.
Les limites actuelles des publications sur arts et santé
L’analyse critique des études citées dans des revues récentes et des méta-analyses montre des faiblesses méthodologiques (absence de définition de l’art comme agent thérapeutique, manque de randomisation pour l’affectation aux groupes, conditions contrôles inadéquates, effectifs faibles, ou encore analyses statistiques inappropriées) et un manque général de soutien empirique à la notion que l’art influence directement la santé et le bien-être.
En outre, les preuves expérimentales liant l’art à des processus neuronaux ou physiologiques spécifiques restent quasi-inexistantes. Même si des études ont identifié des corrélats neuronaux de l’engagement artistique, elles n’ont pas apporté la preuve que ces mécanismes sont uniques à l’art ou qu’ils ont un impact causal sur les résultats.
Si l’idée que l’art peut améliorer la santé est attrayante et culturellement résonnante, il est aujourd’hui fondamental d’approfondir les recherches sur les arts et la santé en respectant les normes les plus élevées de la méthodologie des essais cliniques.
Prévention santé, prise en charge des malades… des bénéfices potentiels à valider
De nombreux éléments d’études scientifiques sont disponibles et prêtent aux arts de multiples bénéfices pour la santé et le bien-être. Ils sont à considérer avec précaution.
Les arts contribueraient ainsi à la prévention en santé, en réduisant notamment le risque de déclin cognitif et de mortalité prématurée. L’OMS estime qu’ils favoriseraient la prise en charge de maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies respiratoires, le diabète, les maladies cardiovasculaires… Ils pourraient également être un soutien aux soins de fin de vie.
Les arts aideraient, par ailleurs, les personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux et neurologiques incluant les troubles du spectre autistique (TSA), la paralysie cérébrale, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), la sclérose en plaques, les démences…
Les arts favoriseraient en outre le développement de l’enfant en contribuant au lien mère-enfant, à l’acquisition du langage, ou encore à la réussite scolaire.
Il a aussi été rapporté que les arts influenceraient les déterminants sociaux de la santé tels que la cohésion sociale et la réduction des inégalités et iniquités sociales.
Un protocole innovant au sein du musée des Beaux-Arts de Caen
Notre projet « Art, Bien-être et Cerveau » est porté par le groupement d’intérêt scientifique « Blood & Brain @ Caen Normandie » (BB@C), le musée des Beaux-Arts de Caen, le Centre hospitalier universitaire de Caen et le réseau professionnel des arts et des cultures numériques en Normandie (Oblique/s), dans le cadre des festivités du Millénaire de la ville de Caen.
Dans ce projet, nous étudions l’effet de visites au musée chez 200 participants à l’aide d’un protocole expérimental en deux visites au musée des beaux-arts. Les participants seront répartis en trois groupes : deux groupes expérimentaux de 80 participants (l’un avec médiation, l’autre sans médiation) et un groupe contrôle (40 participants).
Lors de la première visite, les groupes expérimentaux effectueront la visite du musée de manière individuelle durant laquelle ils bénéficieront, ou non, d’une médiation culturelle.
Ils seront tous équipés de lunettes d’eye-tracking (pour l’enregistrement des mouvements oculaires), d’un bandeau NIRS (Near InfraRed Spectroscopy, pour l’enregistrement de l’activité cérébrale) et d’un capteur d’activité électrodermale (pour l’analyse des réponses cardiaques et électrodermales, qui correspondent aux variations électriques de la peau liées au fonctionnement des glandes sudoripares).
Pour la seconde visite, les participants effectueront la visite du musée en binôme, avec ou sans médiation.
Avant et après la visite, ils répondront à différents questionnaires (émotionnel, bien-être et stress) et réaliseront des tâches cognitives mesurant les fonctions exécutives, l’attention visuelle, la mémoire épisodique, l’empathie et la créativité.
Le groupe contrôle effectuera deux visites au musée, comme les groupes expérimentaux, mais sans équipement ni médiation. Ces participants répondront uniquement aux questionnaires et aux tests cognitifs.
Questionnaires, tests cognitifs et enregistrements de l’activité cérébrale
Les questionnaires et les tests cognitifs permettront de déterminer si la découverte des œuvres, ainsi que la médiation proposée, entraînent une augmentation du bien-être et des capacités cognitives.
Afin de recueillir des mesures physiologiques de la réponse émotionnelle, des enregistrements des réponses électrodermales et cardiaques lors de l’exposition aux tableaux seront réalisés à l’aide d’un biocapteur porté au poignet par les participants.
Nous formulons l’hypothèse que les participants présenteront de meilleures capacités exécutives après la visite, avec un gain plus marqué chez les volontaires dans un état émotionnel positif. Nous postulons également que les capacités de traitements visuospatiaux des participants bénéficieront de la médiation du professionnel.
La NIRS, une technique d’imagerie optique non invasive, sera utilisée pour enregistrer l’activité du cortex préfrontal lors de l’analyse de l’œuvre picturale. Elle renseignera sur l’engagement émotionnel et la synchronisation cérébrale entre les participants.
Nous nous attendons, entre autres, à ce que la variation des réponses émotionnelles à toutes les mesures effectuées (questionnaires, capteur d’activité électrodermale) soit en lien avec des variations de l’activation du circuit fronto-limbique. Enfin, les mesures oculométriques (eye-tracking) permettront d’analyser les liens entre la médiation et les stratégies d’exploration visuelle des participants.
Cette recherche, combinée à d’autres, pourrait avoir différentes implications : favoriser la synergie entre politiques culturelles et de santé ; concevoir des expériences muséales au plus près du fonctionnement humain ; ouvrir sur de nouvelles perspectives comme le rôle de l’exposition à l’art dans le maintien en bonne santé, avec la possibilité à plus long terme d’envisager des recherches sur d’autres arts ; ouvrir à d’autres études du même type associant binômes patients-aidants, jeunes-seniors, etc…
Publié: 28 juillet 2025
Source : https://theconversation.com/
Auteurs Véronique Agin – Professeur en neurosciences, Université de Caen Normandie
Denis Vivien Professeur en biologie cellulaire et praticien hospitalier au Centre Hospitalier Universitaire Caen Normandie, Université de Caen Normandie
Le rôle de l’art dans la prévention en santé, mais aussi dans l’aide à la prise en charge des malades dans différentes pathologies, est de plus en plus accepté. Mais ses bénéfices doivent encore être validés en respectant les normes des essais cliniques. C’est l’objectif d’un projet de recherche mené au musée des Beaux-Arts de Caen, en Normandie, qui allie neurosciences, psychologie et sciences numériques.
Définir l’art et la santé est une question difficile mais fondamentale avant d’initier une recherche sur les liens entre les arts et la santé.
L’œuvre d’art est valorisée en soi, sa finalité n’est pas d’être utile. Elle incarne la nouveauté, la créativité, l’originalité, le travail de recherche et le savoir-faire de l’artiste. Elle suscite en outre l’imagination et l’expression émotionnelle aussi bien chez l’artiste que chez le spectateur.
La santé, quant à elle, peut être définie comme un état de bien-être mental, physique et social, et non pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité, ce qui ancre ainsi fermement la santé dans la société et la culture.
De nombreux articles scientifiques affirment que les arts pourraient améliorer la santé, et donc le bien-être des individus. En 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a répertorié deux grandes catégories d’effets possiblement bénéfiques des arts sur la santé : prévention et promotion de la santé, prise en charge et traitement.
Un projet qui rassemble neurosciences, psychologie et sciences numériques
L’art peut-il améliorer la santé et donc le bien-être ?
Pour contribuer à lever les incertitudes, nous menons un projet pluridisciplinaire « Art, bien-être et cerveau » qui rassemble les neurosciences (laboratoire PhIND : UMR-S Inserm 1237), la psychologie (laboratoire NIHM : UMR-S 1077 ; laboratoire LaPsyDÉ : UMR CNRS 8240) et les sciences numériques (laboratoire GREYC : UMR CNRS 6072).
Cette recherche innovante, menée au musée des Beaux-Arts de Caen, a pour objectif de mesurer, in situ, les effets procurés par la visite d’un musée dédié à la peinture sur le bien-être, chez des adultes en bonne santé âgés de 18 à 65 ans.
Il s’agit également d’identifier les mécanismes cérébraux, cognitifs et socioémotionnelsassociés à ces effets, grâce à des mesures exhaustives et écologiquement adaptées.
Les limites actuelles des publications sur arts et santé
L’analyse critique des études citées dans des revues récentes et des méta-analyses montre des faiblesses méthodologiques (absence de définition de l’art comme agent thérapeutique, manque de randomisation pour l’affectation aux groupes, conditions contrôles inadéquates, effectifs faibles, ou encore analyses statistiques inappropriées) et un manque général de soutien empirique à la notion que l’art influence directement la santé et le bien-être.
En outre, les preuves expérimentales liant l’art à des processus neuronaux ou physiologiques spécifiques restent quasi-inexistantes. Même si des études ont identifié des corrélats neuronaux de l’engagement artistique, elles n’ont pas apporté la preuve que ces mécanismes sont uniques à l’art ou qu’ils ont un impact causal sur les résultats.
Si l’idée que l’art peut améliorer la santé est attrayante et culturellement résonnante, il est aujourd’hui fondamental d’approfondir les recherches sur les arts et la santé en respectant les normes les plus élevées de la méthodologie des essais cliniques.
Prévention santé, prise en charge des malades… des bénéfices potentiels à valider
De nombreux éléments d’études scientifiques sont disponibles et prêtent aux arts de multiples bénéfices pour la santé et le bien-être. Ils sont à considérer avec précaution.
Les arts contribueraient ainsi à la prévention en santé, en réduisant notamment le risque de déclin cognitif et de mortalité prématurée. L’OMS estime qu’ils favoriseraient la prise en charge de maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies respiratoires, le diabète, les maladies cardiovasculaires… Ils pourraient également être un soutien aux soins de fin de vie.
Les arts aideraient, par ailleurs, les personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux et neurologiques incluant les troubles du spectre autistique (TSA), la paralysie cérébrale, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), la sclérose en plaques, les démences…
Les arts favoriseraient en outre le développement de l’enfant en contribuant au lien mère-enfant, à l’acquisition du langage, ou encore à la réussite scolaire.
Il a aussi été rapporté que les arts influenceraient les déterminants sociaux de la santé tels que la cohésion sociale et la réduction des inégalités et iniquités sociales.
Un protocole innovant au sein du musée des Beaux-Arts de Caen
Notre projet « Art, Bien-être et Cerveau » est porté par le groupement d’intérêt scientifique « Blood & Brain @ Caen Normandie » (BB@C), le musée des Beaux-Arts de Caen, le Centre hospitalier universitaire de Caen et le réseau professionnel des arts et des cultures numériques en Normandie (Oblique/s), dans le cadre des festivités du Millénaire de la ville de Caen.
Dans ce projet, nous étudions l’effet de visites au musée chez 200 participants à l’aide d’un protocole expérimental en deux visites au musée des beaux-arts. Les participants seront répartis en trois groupes : deux groupes expérimentaux de 80 participants (l’un avec médiation, l’autre sans médiation) et un groupe contrôle (40 participants).
Lors de la première visite, les groupes expérimentaux effectueront la visite du musée de manière individuelle durant laquelle ils bénéficieront, ou non, d’une médiation culturelle.
Ils seront tous équipés de lunettes d’eye-tracking (pour l’enregistrement des mouvements oculaires), d’un bandeau NIRS (Near InfraRed Spectroscopy, pour l’enregistrement de l’activité cérébrale) et d’un capteur d’activité électrodermale (pour l’analyse des réponses cardiaques et électrodermales, qui correspondent aux variations électriques de la peau liées au fonctionnement des glandes sudoripares).
Pour la seconde visite, les participants effectueront la visite du musée en binôme, avec ou sans médiation.
Avant et après la visite, ils répondront à différents questionnaires (émotionnel, bien-être et stress) et réaliseront des tâches cognitives mesurant les fonctions exécutives, l’attention visuelle, la mémoire épisodique, l’empathie et la créativité.
Le groupe contrôle effectuera deux visites au musée, comme les groupes expérimentaux, mais sans équipement ni médiation. Ces participants répondront uniquement aux questionnaires et aux tests cognitifs.
Questionnaires, tests cognitifs et enregistrements de l’activité cérébrale
Les questionnaires et les tests cognitifs permettront de déterminer si la découverte des œuvres, ainsi que la médiation proposée, entraînent une augmentation du bien-être et des capacités cognitives.
Afin de recueillir des mesures physiologiques de la réponse émotionnelle, des enregistrements des réponses électrodermales et cardiaques lors de l’exposition aux tableaux seront réalisés à l’aide d’un biocapteur porté au poignet par les participants.
Nous formulons l’hypothèse que les participants présenteront de meilleures capacités exécutives après la visite, avec un gain plus marqué chez les volontaires dans un état émotionnel positif. Nous postulons également que les capacités de traitements visuospatiaux des participants bénéficieront de la médiation du professionnel.
La NIRS, une technique d’imagerie optique non invasive, sera utilisée pour enregistrer l’activité du cortex préfrontal lors de l’analyse de l’œuvre picturale. Elle renseignera sur l’engagement émotionnel et la synchronisation cérébrale entre les participants.
Nous nous attendons, entre autres, à ce que la variation des réponses émotionnelles à toutes les mesures effectuées (questionnaires, capteur d’activité électrodermale) soit en lien avec des variations de l’activation du circuit fronto-limbique. Enfin, les mesures oculométriques (eye-tracking) permettront d’analyser les liens entre la médiation et les stratégies d’exploration visuelle des participants.
Cette recherche, combinée à d’autres, pourrait avoir différentes implications : favoriser la synergie entre politiques culturelles et de santé ; concevoir des expériences muséales au plus près du fonctionnement humain ; ouvrir sur de nouvelles perspectives comme le rôle de l’exposition à l’art dans le maintien en bonne santé, avec la possibilité à plus long terme d’envisager des recherches sur d’autres arts ; ouvrir à d’autres études du même type associant binômes patients-aidants, jeunes-seniors, etc…
Publié: 28 juillet 2025
Source : https://theconversation.com/